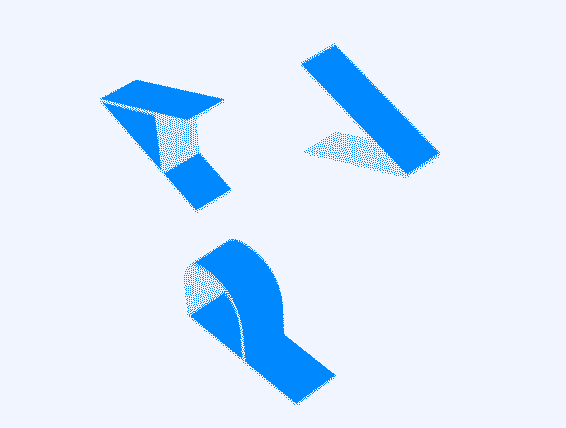
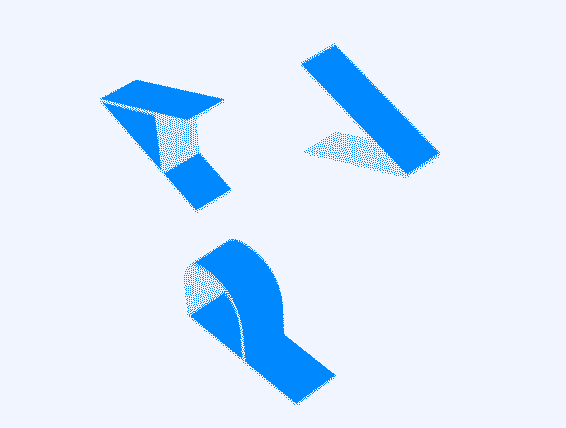

Pourquoi revenir dans votre village natal après ces longues années passées aux Émirats arabes unis et surtout en Éthiopie où vous avez mené une intense activité d’artiste et de galeriste ? En quoi ces déplacements ont-ils affecté et continuent d’affecter votre travail ?
Embrasser l’inertie ? J’ai laissé à Chrysomallos sa toison et ne sais si je m’en retourne plein de raison. Cependant, de l’usage du monde, je subirai quelques temps encore les dommages collatéraux. La prosaïque réalité de mon émigration reflète équitablement un désir profond de ne point refuser le désir de se laisser porter par le flux providentiel, que de savoir en trouver les leviers afin de provoquer les conditions pour que les choses existent réellement. Il en est de même pour cette impatriation. L’inéluctabilité de certains événements prévaut. Dans le prolongement de ce que j’avais vécu à l’Université de Haute-Bretagne et au Domaine de Kerguéhennec, sous l’inspirante direction de Denys Zacharopoulos, j’ai cherché dans l’ailleurs, de nouveaux points de déséquilibre et d’inédites confrontations. Ces engagements sur les scènes artistiques de zones grises m’ont permis de questionner profondément les fondations sur lesquels je pensais établir une pensée et une action artistique « contemporaine ». Puis le temps est arrivé où ce point de fuite, sans cesse plus fuyant encore, ne suscitait plus chez moi tout à fait la même émotion.
En quoi consiste le concept d’iconographie que vous déclarez être au centre de votre pratique : est-ce le besoin de rendre compte de ce « maëlstrom d’images » mixant références sacrés et profanes ?
Il n’y a je pense aucun besoin de rendre-compte de quoi que cela soit. Cependant, cette complexité d’influences a un impact direct et durable sur ma production actuelle. Ce que j’exhale dépend de ce que j’inhale : la capacité à produire du sens à travers pièces, installations, performances, ma pratique de l’enseignement également, tout cela participe d’une écriture poétique plus proche du cadavre exquis que du rapport d’activité. Cette question du sacré/profane occupe une place centrale dans mon travail : atavisme mis de côté, elle est indubitablement liée à l’étude de l’iconographie orthodoxe éthiopienne et musulmane du Moyen-Orient. Augmentées par le contrepoint de la proximité vécue avec les peintures de propagande des années de la Terreur Rouge, ces fréquentations façonnent mon approche du processus créatif et de la notion hyper européocentrique de la contemporanéité que je redécouvre ici. Ainsi, entre maturation et pourrissement, se créé un terreau fertile dans lequel je puise ardemment. Sans doute est-ce cela ce maelström d’images.
Comment envisagez-vous votre parcours à venir en France ? Comment pensez-vous réinscrire ce capital culturel que vous avez accumulé à travers vos voyages dans votre pratique et vos projets futurs ?
Je n’envisage pas plus mon parcours en France que je n’ai —ou n’avais— de plan de carrière quand je me suis installé en Éthiopie, à Dubai ou à Londres. Je suis là c’est tout. Et en même temps, jamais là où l’on m’attend (bel épitaphe par ailleurs). Actuellement, nous traduisons en mandarin le catalogue de l’exposition Tomber du ciel comme un éclair – VI Variations puisqu’il y a du côté de Taïwan des choses qui m’intéressent. Je suis reclus dans mon atelier et je continue le travail. Je présente à Angers à la mi-avril, une nouvelle série d’études, de grands formats Douze heures de jour —X variations… Nous verrons bien.
Patrice Joly